Par Guy Carassus*.
Si l’enjeu fondamental de notre époque reste le dépassement du capitalisme – face aux défis anthropologiques (développement humain, égalité femme/homme, nouvel ordre mondial, etc.) et écologiques (lutte contre le dérèglement climatique, pour le maintien de la biodiversité naturelle et cultivée, etc.) auxquels sont confrontés les sociétés humaines – alors il faut réinvestir le travail et le monde du travail de toute urgence. Il y a plusieurs raisons à cela. Je voudrais en indiquer trois brièvement. La première réside dans le fait que l’émancipation du travail passe nécessairement par le renversement de la domination qu’exerce le capital dans les sphères économiques ; la seconde se rapporte au constat que le monde du travail est au cœur d’une activité politique et idéologique des plus intense, menée sous couvert de management ; la dernière se révèle dans les résistances qu’opposent les salariés dans leur travail -sous des formes très diverses et parfois ignorées- à la domination capitaliste sur les activités productives, et qui cachent un réservoir d’alternatives qui flèchent les voies possibles pour une transformation sociale systémique.
La centralité du travail pour une visée d’émancipation sociale
Le capitalisme ne peut exister sans le travail vivant -l’inverse n’est pas vrai car il n’y a pas de nécessité absolue à ce que l’argent fonction comme un capital- car celui-ci est un rapport social qui repose sur la création de valeur d’échange et l’accumulation de plus-value qui en est retirée. Or cette valeur n’est produite que dans le cadre de procès productifs de biens et de services, complexes et diversifiés où les hommes entrent en relation, entre eux et avec la nature, dans une grande variété de travails des champs privé comme public.
Il faut bien voir à quelles conditions se fait cette perpétuation et cette extension de l’emprise du capital sur les activités productives humaines. De manière très schématique, l’exigence de créer une valeur toujours plus grande que celle engagée initialement (le capital est une valeur qui se met en valeur) pousse à accroître les productions tout en abaissant les coûts afférents à celle-ci. Mais dans ce processus de diminution des « coûts » pour une rentabilité maximale -dont la concurrence accroît la férocité, ce sont les dépenses pour les femmes et les hommes qui sont principalement visées (salaires, cotisations sociales, formation, etc.), ainsi que celles liées à la préservation des milieux naturels et à l’équilibre des écosystèmes auxquels ils participent. Quand les exigences de rentabilité et de profitabilité augmentent avec l’accumulation du capital, les prélèvements sur la richesse créée qui ont pour objectif d’assurer une part des conditions d’une vie digne dans un environnement préservé sont mis en cause : diminués, externalisés sur les populations ou non assumés. La plus-value à la source du profit et de sa croissance se paient au prix fort : celui de l’exploitation des femmes, des hommes et de la nature sur la planète entière.
Cette façon de faire économie, en fonction des intérêts de classe d’une oligarchie qui a su y plier la société, imprime un type de croissance de la productivité du travail aux effets très contradictoires : d’une part, à des fins d’augmentation des profits, le capital tend à remplacer prioritairement le travail vivant par des machines désormais dopées à l’intelligence artificielle ; d’autre part, les gains de temps ainsi acquis dans les activités productives se transforment soit en surexploitation, soit en chômage et précarité. Si le profit et les actionnaires y trouvent leur compte, les salariés et les sociétés y voient leurs intérêts communs sacrifiés. Or le défi majeur de nos sociétés est de transformer les gains de productivité en temps rendu disponible pour des activités liées à l’acquisition de nouvelles capacités d’intervention des femmes et des hommes, capacités qui viseront à leur donner une plus grande maîtrise d’initiative et de décision sur les processus productifs -comme sur la vie sociale en général- afin de les conduire selon des critères de justice sociale et conformément au respect des équilibres naturels et écosystémiques dont nous dépendons. C’est donc un progrès gigantesque du développement humain, aux dimensions anthropologiques et écologiques inédites, qu’il est nécessaire d’entreprendre pour répondre aux enjeux de notre temps. Et ce sont ces individus sociaux richement développés qui feront progresser à nouveaux frais l’efficience et l’efficacité des activités productives. Les possibilités d’y parvenir existent en creux dans cette société et passe par une diminution du temps de travail de tous au profit d’un temps disponible pour une multiplicité d’activités (formation, culture, créations, bénévolat, sports, loisirs, etc.) -source d’emploi- où l’individu social s’élargira. Mais également par une transformation du travail lui-même pour qu’il s’appuie et vise l’épanouissement des personnes.
Ces processus capitalistes ne jouent pas de façon unilatérale -ils sont tendanciels et contradictoires- mais ils impriment une direction qui va à l’encontre d’un progrès social, écologique et démocratique des sociétés. Ils sont au fondement des obstacles sur lesquels butent un nouveau développement humain inscrit dans une perspective émancipatrice. Il faudra bien affronter la question de leur dépassement par des transitions et des ruptures au sein même des entreprises.
La bataille de l’hégémonie culturelle dans l’entreprise
D’autant que tout est fait pour leur perpétuation sur un plan pratique et idéologique. Le vecteur principal de ce combat est aujourd’hui le management. Plus précisément, un certain management. Celui qui s’emploie à individualiser les rapports de travail en détruisant les solidarités collectives et les organisations qui les supportent. Celui qui vise à accroître la production de valeur pour les actionnaires en déclinant cet objectif délétère en horizon du travail de chaque salarié. Celui qui instaure des normes d’évaluation pour emprisonner le travail quotidien dans le carcan de la rentabilité et assujettir les esprits aux logiques du marché concurrentiel.
Il faut prendre la mesure de cette vaste entreprise de subordination du travail et des salariés : faire de l’activité qui supporte une large part de l’existence individuelle et sociale un espace où se façonne un rapport au monde, pratique et concret, qui susurre ou hurle qu’il n’est d’autre alternative que le capitalisme pour faire économie. Trois éléments concourent activement quoique sur des plans différents, à imposer cette subordination que sanctifie, au plan juridique, le contrat de travail.
Le premier prend appui sur les productions idéologiques que génère le mouvement contradictoire du capital et qui ont pu être identifiées par Marx sous le vocable de fétichisme de la marchandise et du capital, ou encore d’aliénation vis-à-vis des puissances sociales, du produit du travail, etc. Un ensemble de phénomènes dignes d’une « camera obscura » qui inverse et renverse l’image réelle de la primauté des rapports sociaux noués dans le travail, reléguant ainsi les salariés au rang de créature chosifiée du capital rendus étrangers à leur propres productions, leur interdisant ainsi de s’approprier les potentialités de développement humain qu’elles recèlent pour chacun.
Le second provient de cette raison déraisonnable qu’instaure une forme de naturalisation de règles économiques, issues de pratiques sociales orientées par les intérêts de la classe dominante, et qui tendent à s’imposer à tous les acteurs du champ social à l’instar des normes imprescriptibles. Il y a là comme l’instauration d’un déterminisme économique -prétendu tel- fait pour surplomber la raison citoyenne et les choix qui en découlent. Toute pensée alternative n’est qu’utopie. Hors du marché, de la concurrence et du profit point de salut.
Le troisième relève des politiques publiques qui, ces dernières années, n’ont pas cessé de fragiliser les salariés en défaisant les droits sociaux et syndicaux (code du travail, prud’homme, retraite, etc.). L’objectif est clair. Il s’agit de renforcer leur dépendance face à la toute puissance patronale en les mettant à la merci de choix légitimés par doxa libérale. De fait, l’entreprise est le lieu où s’abolit la citoyenneté au profit d’une monarchie patronale qui règne sans partage sur les décisions et les orientations à caractère socio-économiques mais qui régentent la vie sociale bien au-delà de ce périmètre.
Ces facteurs managériaux, idéologiques et in fine politiques laissent entendre combien la bataille des idées est menée avec une pugnace volonté de remporter l’hégémonie culturelle à l’entreprise en créant les conditions structurelles d’un rapport au monde qui conforte les positions des dominants. Cette situation ne pourra être plus longtemps minorée par les forces qui visent l’émancipation sociale et humaine. Et l’un des points d’appui concret pour la renverser devra être l’autogestion comme pratique d’une gouvernance collective, par les producteurs et les citoyens, en vertu d’objectifs et de valeurs qui substituent la création de richesses pour les populations à celle pour les actionnaires, la valeur d’usage à celle d’échange, l’utilité sociale et la viabilité écologique à la rentabilité, l’efficacité et l’efficience à la productivité, la coopération à la concurrence, etc. En somme, l’intérêt général à l’intérêt privé dans les activités économiques et sociales.
Des salariés porteurs d’alternatives
Ces visées transformatrices ne sont pas une vue de l’esprit. Leurs prémices existent bel et bien dans les réalités contemporaines du monde du travail mais restent prisonnières de rapports de domination qui les entravent voire les dévoient parfois. Elles existent dans les activités productives sous des formes variables.
On les découvre, en tout premier lieu, avec les luttes sociales qui résistent aux restructurations capitalistes des entreprises et au démantèlement des services publics pour les mettre au diapason des politiques néolibérales. Dans ces mouvements sociaux, ce qui est souventefois tu ou occulté est la parole des salariés et de leurs organisations syndicales qui tentent d’ouvrir des perspectives alternatives aux décisions patronales et gouvernementales. Elles expriment pourtant les potentialités qui pourraient se matérialiser à grande échelle par d’autres orientations socio-économiques si les choix et les intérêts financiers étaient remis en cause au profit d’une logique qui privilégierait le développement humain et l’intérêt général.
On les voient exister dans la sphère de l’économie sociale et solidaire malgré les limites et les obstacles que peuvent imposer les règles du marché concurrentiel. Des associations dont la boussole est un projet d’intérêt commun, inventent des prises en charge originales de nouvelles questions sociales et environnementales. Des coopératives où la détention du capital par des coopérateurs n’exige pas une rentabilité maximale, parviennent à maintenir et à développer des activités économiques. Des mutuelles inscrites dans des démarches solidaires réussissent à proposer des couvertures santé selon les besoins des personnes et non en fonction de leur revenu comme cela se pratique dans le secteur assurantiel. Mais cela reste limité. Hormis certains types de coopératives (de travail, d’intérêt collectif), le rapport du projet fondateur à l’intérêt général comme le statut des salariés sont l’objet d’une grande variabilité pas toujours en leur faveur…
Pourtant, il est une dimension de cette résistance, et des potentialités transformatrices qu’elle recèle, grandement méconnues voire négligées alors que sa portée créatrice pourrait s’avérer décisive si on parvenait à lui donner toute sa force. Elle réside dans les caractéristiques du travail accompli par les femmes et les hommes dans nombre de procès productifs. Des sociologues du travail (plus précisément celles et ceux qui pratiquent l’ergologie) ont pu montrer qu’il n’est de prescription délivrée qui ne doive être réinterprétée ou ré-élaborée pour atteindre les objectifs qu’elle assigne au salarié. Il faut bien entendre ce qui s’énonce là : tout salarié est conduit à faire œuvre de créativité pour accomplir le travail prescrit. Cette nécessaire inventivité se développe en fonction de valeurs -pour une part inspirées par l’expérience du travail collectif- qui instaurent une forme de normativité qui règle les décisions et les arbitrages pris dans le quotidien du travail. Et lui donne sens.
Il y a là toute l’imprescriptibilité du travail vivant dans toute tâche productive. Mais il y a également mise en œuvre de capacités créatrices originales, orientées par une éthique de responsabilité, nourries par l’expérience et l’échange au sein du collectif de travail, qui tendent à affirmer le besoin de faire place à l’intervention des salariés dans la vie de toute entité économique et sociale. Donner accès à la satisfaction de ce besoin passe par l’octroi d’une pleine citoyenneté dans le monde du travail qui favorise la libération de la parole et la participation des salarié.es. Cela doit faire l’objet d’un nouveau droit humain pour tous les salariés : un droit à intervenir dans le cadre d’une démocratie sociale autogestionnaire. Cela devrait devenir une revendication politique de première importance pour qui veut émanciper le travail.
* Guy Carassus se définit comme un activiste dilettante de l’émancipation du travail et des travailleur.euse.s. par eux-mêmes.


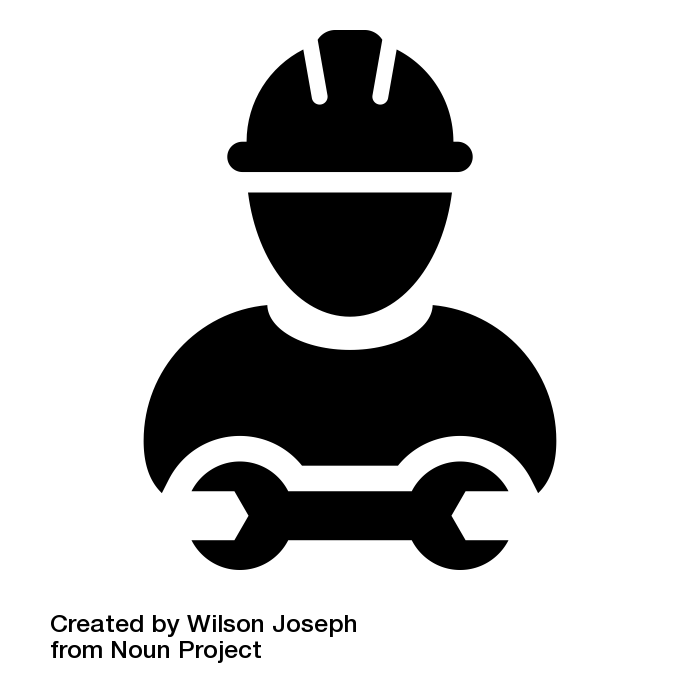












Vous devez être connecté pour publier un commentaire. Login