22 mars 2020
L’arrêt du 4 mars 2020 par lequel la Cour de cassation a qualifié la relation entre un chauffeur UBER et la Multinationale néerlandaise a été à juste titre salué comme un coup porté au modèle économique à laquelle ladite multinationale a donné son nom.
On commencera par observer que les brillants cerveaux qui ont inventé ce système ne sont pas les premiers à tenter de contourner le code du travail et les protections que celui-ci comporte encore aujourd’hui malgré les reculs qu’il a connu depuis plusieurs décennies.
Les tentatives de contournement des lois sociales sont aussi anciennes que ces lois elles-mêmes
Pour un employeur, disposer d’une main d’œuvre sans avoir à s’affranchir des obligations qui s’y rattachent, aussi bien s’agissant de l’exécution de la prestation que de la rupture de la relation de travail, constitue un véritable graal. Dans la novlangue chère au Medef, on appelle cela « externaliser le risque emploi ».
Les grandes entreprises se sont ainsi, dès les années 70, séparées de services et de salariés dont elles considéraient qu’ils n’appartenaient pas à leur « cœur de métier ».
Ainsi ont été externalisés, par exemple, la surveillance, le nettoyage, la restauration etc…
Les travailleurs concernés conservaient leur statut de salarié mais changeaient d’employeur… sans bouger de leur lieu de travail.
L’on pouvait dès lors, au sein d’une même entreprise, croiser des salariés qui travaillaient ensemble, dans les mêmes locaux, mais qui n’avaient pas les mêmes droits, ne relevaient pas de la même convention collective et n’avaient pas accès aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise…
Des années de bataille syndicale et jurisprudentielle seront nécessaires pour obtenir que ces salariés « extérieurs » soient intégrés dans le décompte des effectifs de l’entreprise d’accueil pour calculer le nombre de représentants du personnel, puis se voient reconnaître le droit de voter aux élections professionnelles de l’entreprise d’accueil…
C’est sur cette frénésie d’externalisation qu’ont également prospéré les sociétés d’intérim dont l’une des 110 propositions du candidat François MITTERRAND prévoyait, en 1981, la suppression.
Encore celles-ci furent-elles soumises à un certain nombre d’obligations…dont le non-respect exposait l’entreprise utilisatrice à des actions en requalification en contrat de travail la liant directement à l’intérimaire.
Pour autant, ces entreprises de travail temporaire ne couvraient qu’insuffisamment les besoins des entreprises dans le domaine des emplois hautement qualifiés et les emplois liés au développement exponentiel des activités informatiques.
C’est dans cette brèche que devaient s’engouffrer, dans les années 90, les « SSII », sociétés de conseil et d’ingénierie, dont l’activité principale consistait à recruter des ingénieurs ou des informaticiens pour les « placer » auprès d’entreprises d’accueil sous prétexte de prestation de service.
Le plus souvent, le seul lien unissant les ingénieurs et informaticiens avec ces SSII, employeurs officiels, était l’établissement d’un bulletin de salaire et le versement de la rémunération.
Ces sociétés ont ainsi pu prospérer dans l’activité de travail temporaire sans avoir à en supporter les, modestes, contraintes. Mais elles réalisaient de très confortables bénéfices au point, pour certaines, de rejoindre le cercle très fermé du CAC 40.
L’imagination des contempteurs du droit du travail vécu comme un « insupportable carcan » ne connaissant pas de limite, une association de cadres au chômage inventa le portage salarial.
Le portage salarial peut être défini comme l’opération par laquelle un travailleur appelé le « porté » confie à une société de portage la facturation et la gestion administrative de missions effectuées auprès d’une entreprise utilisatrice (le client) moyennant le paiement par la première d’un salaire.
Si les SSII se chargeaient de trouver l’entreprise d’accueil auprès de laquelle le salarié était placé, les sociétés de portage salarial ne connaissent même pas cette préoccupation. C’est le « porté » qui se charge de trouver la mission et le client (entreprise d’accueil), la société de portage n’étant tenue que d’établir les bulletins de salaire et de verser la rémunération préalablement versée par l’entreprise d’accueil en prélevant, évidemment sa commission au passage.
Le moins que l’on puisse dire est que les pouvoirs publics, qui disposaient pourtant d’un corpus légal de répression de ces dérives, avec les infractions de prêt de main d’œuvre illicite et de marchandage, ont laissé faire.
Pour mémoire, l’infraction de prêt de main d’œuvre illicite est constituée par « toute opération à but lucratif qui a pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre, dès lors qu’elle n’est pas effectuée dans le cadre de la législation relative au travail temporaire ». (article L 8241-1 du code du travail).
Le délit de marchandage se définit comme « toute opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail » (article L 8231-1 du code du travail)
Les critiques des organisations syndicales, d’une partie de la doctrine universitaire et quelques décisions de justice retentissantes n’ont pas suffit à enrayer cette dérive.
Plus grave encore, au lieu de poursuivre et sanctionner ces pratiques, le choix des pouvoirs publics a été de les encadrer, de donner à ces sociétés le fondement légal qui leur manquait et dont l’absence les exposait, possiblement, à des procédures judiciaires civiles ou même pénales..
Ainsi, la loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » introduisait dans le code du travail un nouvel article prévoyant que « Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. » (article L 1251-64)
Cette même loi prévoyait l’exclusion du portage salarial du champ de l’article L 8241-1 réprimant le prêt de main d’œuvre illicite et le tour était joué.
Le tout au nom de la sécurisation juridique d’une opération jusque-là illégale….Les concepteurs de cette illégalité avaient gagné.
On évoquera alors, avec le portage salarial, un statut intermédiaire entre le salariat et l’indépendant. Un auteur écrira : « le portage rend compatible ce qu’on croyait jusqu’alors inconciliable : l’indépendance professionnelle alliée au bénéfice d’un statut protecteur » (L. Casaux-Labrunée, Avant-propos in Le portage salarial, Fraude ou nouvelle forme d’organisation du travail ?, Colloque du 22 juin 2007 : Semaine sociale Lamy 2007, n° 1332)
On invitera le lecteur à bien retenir ces mots, qui ne manqueront pas de resservir quelques années plus tard.
Comme ne manquera pas de resservir l’antienne selon laquelle l’apparition de ces nouvelles formes juridiques répondrait à une aspiration…des travailleurs eux-mêmes, argument avancé par les SSII et autres promoteurs du portage salarial.
Mais ces différentes formes juridiques avaient encore en commun de reposer sur un contrat de travail, certes de type particulier, mais qui entraînait dans son sillage un certain nombre de droits individuels essentiels, en passant par pertes et profits les droits collectifs.
Il restait encore à explorer et, surtout, exploiter, les insondables ressources du travail indépendant, exclusif de tout contrat de travail et de toute obligation que ce contrat confère à celui qui utilise le travail d’autrui.
Après l’atomisation du contrat de travail, la terre promise du travail indépendant
On observera d’abord qu’UBER n’a rien inventé. Cette exploration ou, pour être plus clair, cette exploitation du travail indépendant remonte à loin, très loin.
Dans les Cloches de Bâle, Louis Aragon décrivait le mouvement des taxis locataires parisiens en 1906…
Les grandes compagnies de taxi ont ainsi créé des sociétés filiales, propriétaires d’un parc automobile et des licences indispensables pour exercer cette profession, lesquelles sociétés louaient ensuite, à des chauffeurs, la voiture et la licence.
Les locataires devaient accomplir un nombre d’heures de travail considérable pour payer la redevance avant de pouvoir commencer à se rémunérer.
Les taxis locataires se voyaient refuser le statut de salarié au motif de leur prétendue indépendance. En effet, moyennant le règlement de la redevance qu’ils payaient à des sociétés écrans des grandes sociétés de taxis, pour disposer d’une voiture et d’une licence, ils devaient travailler des heures durant pour rembourser la société de location avant de pouvoir espérer se verser une très modeste rémunération. Pas de SMIC, pas de protection sociale, pas de congés et, bien évidemment, pas de droit syndical.
Le système ainsi mis en place devait théoriquement mettre les sociétés de location à l’abri de toute difficulté puisque le « flux financier » allait non pas de la société vers le travailleur sous la forme d’un salaire, mais du travailleur vers la société sous la forme d’une redevance.
Il faudra attendre l’an 2000 et des années de bataille juridique pour que la Cour de cassation vienne casser une décision d’une Cour d’Appel qui avait retenu la qualification de « travailleur indépendant » en jugeant : « Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que, nonobstant la dénomination et la qualification données au contrat litigieux, l’accomplissement effectif du travail dans les conditions précitées prévues par ledit contrat et les conditions générales y annexées, plaçait le » locataire » dans un état de subordination à l’égard du » loueur » et qu’en conséquence, sous l’apparence d’un contrat de location d’un » véhicule taxi « , était en fait dissimulée l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Soc 19/12/2000 N° de pourvoi: 98-40572)
Mais là encore, loin de chercher à endiguer et sanctionner cette évolution très inquiétante, le Législateur décida de l’encourager en créant par une loi du 4 août 2008 portant « modernisation de l’économie » le statut d’auto-entrepreneur dont on ne sera pas surpris qu’il ne figure pas dans le code du travail où il est, simplement, évoqué (article L 8221-6-1 du code du travail) comme un motif d’exclusion du délit de travail dissimulé :
« Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »
On observera au passage le soin mis systématiquement par le Législateur, dans l’intitulé de ses lois, pour parer des atours de la « modernité » autant de retours de plusieurs décennies en arrière…
L’auto-entrepreneur est une personne physique, qui exerce une activité commerciale, artisanale ou libérale, à titre principal ou complémentaire, générant moins de 82 200 euros de chiffre d’affaires ou de recettes pour les activités de vente ou moins de 32 900 euros pour les prestations de services et activités libérales, et qui a opté pour un régime simplifié de constitution et de gestion comptable, fiscale et sociale.
Selon le « portail auto-entrepreneur »:
« En 2018, selon la Fédération Nationale des Auto-entrepreneurs, les secteurs les plus dynamiques sous le régime de l’auto-entreprise sont :
- le transport et l’entreposage (33 %)
- les activités immobilières (22 %)
- les activités de soutien aux entreprises (18 %)
- les services à la personne (15,9 %)
- les activités de communication (13,8 %)
- le bâtiment (5,1 %) »
La loi du 8 août 2016, plus connue sous le nom de Loi EL KHOMRI, viendra parachever l’œuvre en introduisant dans le code du travail des dispositions relatives aux travailleurs indépendants des plateformes en leur accordant le droit à la formation professionnelle et le droit d’adhérer à une organisation syndicale. Le seul autre emprunt aux droits reconnus aux salariés, étant l’article L 7342-5 du code du travail aux termes duquel : « Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l’exercice de leur activité. »
Le cadre légal étant ainsi planté, les possibilités infinies conférées par internet ne tardaient évidemment pas à s’engouffrer dans la brèche et les sociétés dites « plateformes », le plus souvent domiciliés dans des pays « à fiscalité accueillante » à investir ce statut qui leur paraissait taillé sur mesure.
Le même portail auto-entrepreneur publiait, le 26 août 2019, le communiqué suivant :
« Vous aimez la conduite, les beaux véhicules et le contact avec la clientèle ? Le métier de chauffeur VTC est peut-être fait pour vous ! Cette activité est totalement compatible avec le statut simplifié de l’auto-entreprise, mais vous devez respecter certaines obligations. La rédaction décrypte pour vous la réglementation autour de ce métier et vous guide pour créer votre auto-entreprise. »
Aussi beau qu’un appartement témoin en zone inondable….
C’est dans ce contexte que surviendront les décisions de justice, européennes et nationales, qui viendront calmer les ardeurs des plateformes en route vers ce nouvel Eldorado.
Les plateformes à l’épreuve du droit
Comme de plus en plus souvent depuis que les législations sociales nationales, à commencer par la nôtre, sont en recul, le premier signal vint de la Cour de justice de l’union européenne qui, par une décision en date du 20 décembre 2017, qualifiait UBER POP de prestataire de transports alors que la société prétendait être un prestataire de services de l’information. (CJUE 20/12/2017 Asociacion Elite Taxi C/ System Spain SL ).
Pour justifier sa position, la Cour retenait « qu’il ressort des informations dont la Cour dispose que le service d’intermédiation d’Uber repose sur la sélection de chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule auxquels cette société fournit une application sans laquelle, d’une part, ces chauffeurs ne seraient pas amenés à fournir des services de transport et, d’autre part, les personnes désireuses d’effectuer un déplacement urbain n’auraient pas recours aux services desdits chauffeurs. De surcroît, Uber exerce une influence décisive sur les conditions de la prestation de tels chauffeurs. Sur ce dernier point, il apparaît notamment qu’Uber établit, au moyen de l’application éponyme, à tout le moins le prix maximum de la course, que cette société collecte ce prix auprès du client avant d’en reverser une partie au chauffeur non professionnel du véhicule, et qu’elle exerce un certain contrôle sur la qualité des véhicules et de leurs chauffeurs ainsi que sur le comportement de ces derniers, pouvant entraîner, le cas échéant, leur exclusion ».
Cette décision ne manquait pas de rappeler la jurisprudence SOCIETE GENERALE, arrêt de référence par lequel la Cour de cassation avait jugé que : « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; » ( Cass. Soc. 13 novembre 1996- N° de pourvoi: 94-13187)
C’est donc clairement dans le prolongement de sa jurisprudence et de celle de la CJUE que la Cour de cassation se prononçait sur la plateforme de livraisons de plats à domicile TAKE EAT EASY dans un litige l’opposant à un « auto-entrepreneur » revendiquant la qualité de salarié.
Par son arrêt du 28 novembre 2018 la Cour, après avoir rappelé :
« que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; »
jugeait :
« Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’elle constatait, d’une part, que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celuici et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination, a violé le texte susvisé ; » (Cass. Soc 28 novembre 2018 N° de pourvoi: 17-20079)
A l’instar de ce qui avait été jugé 18 ans auparavant dans l’affaire des taxis-locataires, le mirage de l’indépendance se heurtait à la réalité d’un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction caractérisant le lien de subordination et, par là même, ouvrait la voie à une requalification en contrat de travail.
Quelques semaines plus tard, le 10 janvier 2019, la Cour d’Appel de PARIS statuait dans le même sens en ce qui concerne la société UBER. C’est cet arrêt qui fera l’objet d’un pourvoi en cassation aboutissant à l’arrêt du 4 mars 2020.
Le « modèle économique » des plateformes étant directement menacé, le Gouvernement décidait alors de…voler à son secours.
Ainsi décidait-il de profiter d’un projet de loi sur les mobilités pour prévoir des dispositions assurant aux travailleurs des plateformes un minimum de droits et garanties et prévoyait la possibilité, pour l’entreprise, d’établir, unilatéralement, une « charte » soumise à l’homologation de l’administration du travail contenant :
– les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des
– les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services;
– les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels;
– les mesures visant à améliorer les conditions de travail, prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers;
– les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle;
– les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle;
– la qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur
Mais le meilleur restait à venir…En effet, le projet de loi précisait que lorsqu’elle est homologuée, l’existence de cette charte et le respect de certains engagements qu’elle contient ne pourront constituer des indices de requalification de la relation contractuelle en salariat….
Tel était bien le seul et unique objectif : mettre les plateformes à l’abri de toute action en requalification en contrat de travail…le tout au nom de la « sécurisation de la relation entre la plateforme et le travailleur ».
Cette disposition était déférée au Conseil Constitutionnel qui ; par sa décision du 20 décembre 2019, la jugeait anticonstitutionnelle en retenant que:
« Il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux du droit du travail, et qui comme tels relèvent du domaine de la loi, la détermination du champ d’application du droit du travail et, en particulier, les caractéristiques essentielles du contrat de travail.(…)
Les dispositions contestées permettent aux opérateurs de plateforme de fixer eux-mêmes, dans la charte, les éléments de leur relation avec les travailleurs indépendants qui ne pourront être retenus par le juge pour caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique et, par voie de conséquence, l’existence d’un contrat de travail. Le législateur leur a donc permis de fixer des règles qui relèvent de la loi et, par conséquent, a méconnu l’étendue de sa compétence. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs des requérants à l’encontre de ces dispositions, les mots « et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent article » figurant au trente-neuvième alinéa de l’article 44 sont contraires à la Constitution. »
(Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019- Loi d’orientation des mobilités)
Cette censure mettait donc en évidence le pouvoir exorbitant que le Législateur s’apprêtait à confier aux plateformes : le sien…
A partir de cette décision, les évènements allaient s’accélérer.
Le 14 janvier 2020, Edouard Philippe confiait à Jean-Yves FROUIN, ex-Président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, une mission « afin de définir les différents scénarios envisageables pour construire un cadre permettant la représentation des travailleurs des plateformes numériques ». L’usage du terme « travailleurs » en lieu et place de celui de « salariés » est très illustrant. Tout comme le choix de M. FROUIN qui, au moment de son départ de la présidence de la Chambre sociale de la Cour de cassation était, dans un article du Figaro, salué comme « le juge pro-entreprise qui aura marqué la Cour de cassation ». (Le FIGARO 1er novembre 2018) Cet article commençait par cet « hommage » : « Les avocats des employeurs pourraient le regretter. »
Le 4 février 2020, le Conseil des Prud’hommes de PARIS condamnait au civil la plateforme DELIVEROO pour travail dissimulé. Le 10 février 2020, la Cour d’Appel de DOUAI déclarait la plateforme CLIC and WALK coupable du délit de travail dissimulé.
C’est dans ce contexte qu’intervient l’arrêt UBER du 4 mars 2020.
L’arrêt UBER et ses suites…
Après avoir rappelé, une fois encore, que :
« Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. »
La Cour de cassation rejetait les arguments du pourvoi formé par UBER contre l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en jugeant :
« Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, pour qualifier de contrat de travail la relation entre un chauffeur VTC et la société utilisant une plate-forme numérique et une application afin de mettre en relation des clients et des chauffeurs exerçant sous le statut de travailleur indépendant, retient :
1°) que ce chauffeur a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par cette société, service qui n’existe que grâce à cette plate-forme, à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport,
2°) que le chauffeur se voit imposer un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire,
3°) que la destination finale de la course n’est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui lui convient ou non,
4°) que la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l’accès à son compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques », et déduit de l’ensemble de ces éléments l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et que, dès lors, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif. »
(Cass soc 4 mars 2020 pourvoi n°19-13.316°
Les termes de l’arrêt sont aussi clairs que secs : le statut de travailleur indépendant du chauffeur UBER est fictif.
Il existe bien un lien de subordination caractérisé par un pouvoir de direction au sein d’un service organisé.
Ce statut fictif dissimule une autre réalité juridique : celle d’un contrat de travail.
Ainsi, à deux reprises en quelques mois, la plus haute juridiction sociale du pays a fait voler en éclat le mythe des travailleurs indépendants des plateformes, le Conseil constitutionnel a retoqué la tentative du Gouvernement et de sa majorité de conférer aux plateformes le pouvoir exorbitant de se mettre à l’abri de toute action visant à faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail.
Et quelle est la réaction du Gouvernement ? Elle « tombait » dès le lendemain de l’arrêt :
« La ministre du Travail Muriel Pénicaud a annoncé ce jeudi le lancement d’une mission sur le statut des travailleurs des plateformes et des « propositions d’ici l’été ». « La Cour de cassation juge en droit », a réagi la ministre à l’antenne d’Europe 1. « Ce qu’elle dit c’est qu’aujourd’hui, dans le droit du travail, soit on est un salarié, soit on est un travailleur indépendant ». Or, « on a une zone de flou parce que la grande majorité des travailleurs des plateformes veulent être indépendants, veulent la liberté mais veulent à juste titre aussi avoir des protections », affirme Muriel Pénicaud.
Il faut inventer des règles qui permettent la liberté et la protection (…), tout en donnant un cadre qui est clair pour les plateformes », estime-t-elle, en annonçant le lancement avec le ministre de l’Économie Bruno Le Maire d’une « mission pour que d’ici l’été on ait des propositions sur ce sujet ».
Au lieu de se féliciter du salutaire rappel à l’ordre ainsi adressé par la justice à ce « modèle économique » qui repose sur une fiction juridique, le Gouvernement persiste dans sa quête d’un statut intermédiaire pour « sécuriser » ledit modèle.
Et, très curieusement, c’est la Cour de cassation elle-même qui lui montre la voie dans sa « note explicative » publiée le jour même de l’arrêt sur son site internet, en écrivant :
« Tandis qu’un régime intermédiaire entre le salariat et les indépendants existe dans certains États européens, comme au Royaume-Uni (le régime des “workers”, régime intermédiaire entre les “employees” et les “independents”), ainsi qu’en Italie (contrats de “collaborazione coordinata e continuativa”, “collaborazione a progetto”), le droit français ne connaît que deux statuts, celui d’indépendant et de travailleur salarié. »
Ainsi donc, la seule réponse aux coups de boutoirs d’UBER et des autres plateformes de même nature contre le droit du travail français serait de leur façonner un statut sur mesure. C’est très exactement ce qu’elles attendent.
UBER et les autres ont les moyens de rémunérer des juristes qui n’ont évidemment pas manqué de les alerter sur les risques juridiques de leur activité et elles ne peuvent aujourd’hui feindre l’étonnement ou l’indignation.
C’était le prix à payer dans un pays où, très curieusement, certaines illégalités, principalement celles commises par les employeurs, sont à terme récompensées par un encadrement juridique.
Et le tout, bien évidemment, au nom de l’emploi et pour répondre à cette « irrésistible » aspiration qui pousserait de jeunes chômeurs vers le paradis des plateformes.
Quelques mots, pour finir, sur ledit paradis.
Après la décision susvisée de la Cour d’Appel de PARIS, UBER a, en avril 2019, décidé de publier les chiffres du revenu médian de ses chauffeurs.
Moyennant une connexion hebdomadaire de 45.3 heures, le chiffre d’affaire médian horaire s’établit à 24.81 €, dont il faut déduire :
- les frais de service, TVA et cotisations sociales pour un montant de 18.61 €
- la commission UBER (25%) pour un montant de 6.20 €
ce qui revient à un salaire net horaire de 9.15€. (pour mémoire, le SMIC horaire net est, depuis le 1er janvier 2020, de 7.82 €)
La Ministre du Travail ayant pris l’habitude de s’exprimer à la place des chauffeurs UBER, on peut, sans risque de se tromper, supposer que ceux-ci, rémunérés à un tel tarif, s’accommoderaient fort bien des « contraintes » du contrat de travail et du salariat, surtout quand la « liberté » qui leur a été vendue en tête de gondole, présente toutes les caractéristiques du lien de subordination.
Mais qu’importe puisque, dans la France de 2020, la sécurité n’est pas due aux travailleurs mais aux employeurs.
Hervé Tourniquet, Avocat au Barreau de Paris, Chargé d’enseignement à l’Université de PARIS I.


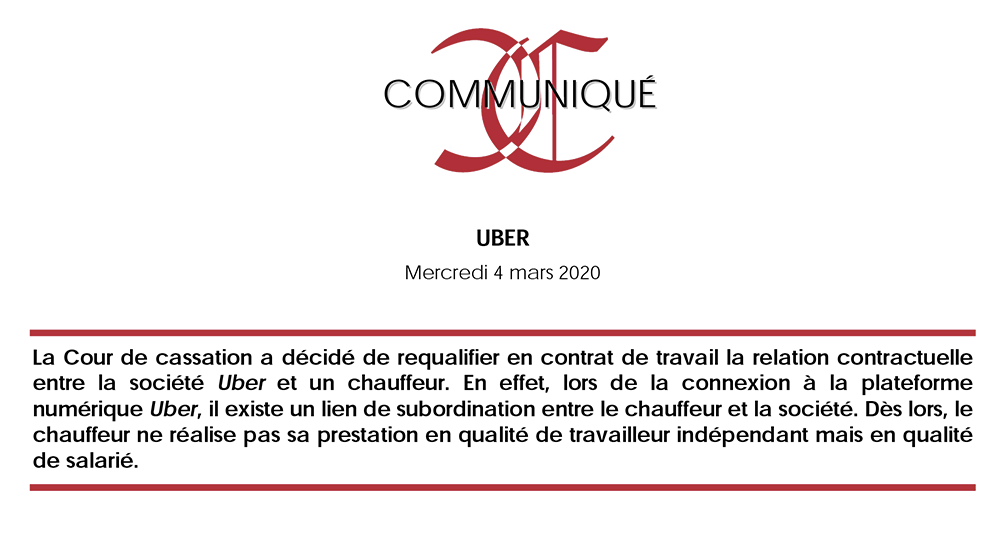












Vous devez être connecté pour publier un commentaire. Login